Géo-Forum #2 : 1/3
Le charme discret du périurbain :
marqueurs et valeurs pour quel Projet ?
Les paysages sont une porte d'entrée privilégiée dans la complexité du territoire, au même titre que la carte, les photographies, ou les textes. Ils en sont la face directement visible par tout un chacun. Les restrictions des déplacements pendant le confinement de mars à juin 2020, à moins d'un kilomètre de chez soi pendant plusieurs semaines, ont conduit à une redécouverte inattendue de la proximité. D'autant plus si, dans les modes de déplacement, la marche et le vélo ont alors pris le dessus sur la voiture. Or, l'expérience personnelle montre que la perception et l'appropriation du territoire et de ses paysages dépend largement de leur plus ou moins grande rapidité : grosso modo elles sont inversement proportionnelles à celle-ci. Plus on évolue lentement à travers les paysages, mieux on se les approprie, on en apprécie les valeurs – qu'elles soient esthétiques, sociales, culturelles et patrimoniales - et en repère les marqueurs.
On appelle marqueurs ce qui attire et accroche le regard dans un paysage, et qui le distingue d'un pur banal qui est pourtant lui-même pas si mal non plus. Quelques exemples : l'escarpement du Sillon de Bretagne, le fleuve Loire ses rives et son estuaire, les clochers et moulins, les cheminées de la centrale de Cordemais, la torchère de la raffinerie de Donges, la « marquise » (grande verrière) de la gare de Savenay, certains bâtiments et édifices du grand patrimoine monumental : abbaye de Blanche-Couronne, couvent des Cordeliers, châteaux de l'Escurays et de Therbé, Ecole Normale devenue lycée...
Tentons ci-dessous un bref retour, en Estuaire et Sillon, sur un siècle de valeurs paysagères et de marqueurs territoriaux : le dernier, pour lequel nous disposons de suffisamment d'éléments. Assez pour souligner variabilité et relativité des marqueurs et de leur valeur paysagère associée. Positive souvent, négative comme dans l'oubli et l'abandon, ou en inversion de polarité - du positif au positif, ou l'inverse – comme avec le couvent des Cordeliers de Savenay ou l'abbaye de Blanche-Couronne à la Chapelle-Launay.
1 – La " fin de [XIXe] siècle" a vu d'étranges convergences nostalgique du temps des moulins à vent, entre d'une part, Jean Rolland, érudit local, ethnographe du territoire, monarchiste, anti-révolutionnaire, et, d'autre part, May Picqueray, anarchiste-révolutionnaire, née à Savenay. Faut-il en tirer trop rapidement la conclusion que le goût des paysages ignore et transcende les clivages politiques ? Ou que ce ne serait simplement qu'une simple affaire de génération ?
a – Jean Rolland (1907-1991), le traditionnaliste, vers 1865
Le récit du roman régionaliste du savenaisien Jean Rolland « Pour Nanon »1, bien que publié en 1957, est censé se passer en 1865 à Savenay, alors encore « sous-préfecture importante » (p.12), mais pour quelques années seulement, avant le transfert de la sous-préfecture à Saint-Nazaire en 1869. On trouve dans ce roman des "amours au Sillon de Bretagne" certaines descriptions de paysages et de lieux. Notamment celle d'une agglomération des villages appelée "le Bas-Savenay" , située au pied du Sillon de Bretagne.Le Bas-Savenay en 1865 : une "petite Hollande"
« Le Bas-Savenay touchait à l'ouest et au sud « le Grand Marais du Syl », lequel n’était autre qu'une portion de la féconde vallée de la Loire. Le Grand Marais était composé de plus de huit cents prairies donnant un foin et un regain drus, de haute qualité. Chaque prairie contenait un hectare environ. Toutes étaient séparées par des douves peu profondes et de larges étiers traversés ça et là par des ponts de bois. L'ensemble avait l'aspect d'une petite Hollande. L'hiver, les crues transformaient le Marais du Syl en un lac immense, riche de canards, vanneaux, sarcelles et courbejeaux [sorte d'échassiers, courlis]. Par ailleurs, les eaux étaient poissonneuses. Les « louves » tendues en fraude sous les larges feuilles de nénuphars et les foënes à anguilles fouillant la vase, ramenaient des pêches appréciables » (p.26)
Mais le Sillon n'est pas qu'un paysage, c'est aussi le cadre d'une sociabilité rurale et villageoise qui culmine au moment des fêtes et foires de villages.
Les foires d'antan à Malville (1865)
Marché à Savenay
« Les foires de jadis étaient pittoresques. Outre les costumes et types locaux (les femmes avec tenue mi-cérémonieuse, les hommes en grand blouse bleue, feutre cabossé et aiguillon en main, tous en sabots taupiers), il y avait des marchands de toutes sortes : marchands de bignons, de jeddes à pain, de paniers et d'auvales à ration pour les vaches, de charrues, de rouelles [roues de charrues et brouettes], de potées de miel, de lin, d'oignons, de pommes de conserve, de guides, de jougs, de courroies de jougs, de tractoires de joug, de traits, d'émouchettes... sans compter ceux spécialisés dans les casses à rillons, les écuelles, les bues à eau, les avouyettes [entonnoirs] à boudins, les buffets [soufflets], le pilou, la laine de ouialle, la plume de oie pour les couettes. Tous ces tableaux croustillants et amusants au possible.
La jeunesse allait par bandes aux grandes foires et non seulement pour les achats divers, mais surtout pour le plaisir, la rencontre des gars, les caquetages, les bals. Les vieux d'aujourd'hui vous parlent de ces foires avec d'intenses regrets... En eux, elles vivent toujours, et rien ne pourra, de nos fêtes modernes, leur apporter un reflet d'antan » (p.61-62)
Cette sociabilité villageoise n'est pas qu'un fantasme rétrospectif d'un nostalgique du temps d'avant. On la retrouve aussi bien dans le témoignage d'une enfance vécue par une jeune savenaisienne rebelle.
B - May Picqueray (1898-1983) l'anarchiste, vers 1910.
 |
| Ruines du moulin de l'Angellerais Cliché Yannick Boucaud |
Dans ses mémoires d'une "réfractaire", pour ses "81 ans d'anarchie" 2, la savenaisienne May Picqueray se souvient de ses vacances chez sa grand-mère maternelle dans le petit village de l'Angeleraye, en fait un hameau de Savenay perché sur le Sillon de Bretagne. « Situé sur une butte, on apercevait la Loire qui déroulait son long ruban argenté et allait se confondre avec la mer à Saint-Nazaire ». Elle évoque notamment le moulin de son oncle, sans doute un Cadoret : « Un petit chemin conduisait au moulin, situé sur une hauteur. Ses grands ailes tournaient au gré des vents. Je grimpais l'escalier en colimaçon qui menait à la grande meule de pierre. Ça sentait bon le blé moulu, la farine. Je descendais de là poudrée comme un Pierrot ». Elle ajoute que « le moulin est la victime d'une bombe explosive de la guerre de 1940 », sans autre précision. « Du train qui va de Nantes à Saint-Nazaire, quelques kilomètres avant l'arrivée à Savenay, on pouvait jadis apercevoir sa fière silhouette. Lors de mon dernier passage, la vue de cette ruine me tordit le cœur ». En fait le moulin - à ne pas confondre avec son proche voisin de la Paquelais, restauré, lui, et ouvert au public – fut plutôt la victime d'un tir américain pendant la Poche en 1644-45, comme beaucoup des clochers des communes limitrophes de son pourtour.
May Picqueray apparaît surtout nostalgique de la vie dans ce hameau, à la veille de la Grande Guerre, au point, certainement, de l'idéaliser un peu :
« Tant de souvenirs de ce moulin, du coquet village déserté de presque tous ses habitants. Les foins, les moissons, les vendanges, autant de fêtes où la joie de la jeunesse se donnait libre cours. Tout était en commun, la bonne entente régnait parmi ces villageois. Une quinzaine de familles, chacune avec quatre ou cinq enfants, vivaient dans le travail, l'entraide, la gaieté ». Elle évoque ainsi les fêtes à l'occasion d'un « mariage dans la grange tendue de draps blancs, toute fleurie, les grandes tables alignées garnies de rôtis, de civets, de pâtisseries ; les bonnes trognes des paysans ; n'est-ce pas les Briand, les Gatepaille, les Leray, et les autres, qui ne se faisaient pas prier pour pousser le chansonnette au dessert ? Les danses sur l'aire au son des violons. Les bons coups de cidre bien frais, tirés à même le tonneau, les bouteilles de vin vieux qu'on sortait pour les grandes occasions. La joie de vivre, la vie dure, simple et tranquille... souvenirs... » (p.32).
Un paradis perdu ? La suite de ses mémoires est loin d'être à l'unisson de ces premiers souvenirs.
2 – Milieu du XXe siècle : "coup de mou" dépréciatif de l'espace et de ses paysages
Pour le géographe Yves Lacoste, l'observation du paysage, qui permet d'englober du regard les différents éléments de l'espace où l'on vit, que l'on croit si bien connaître, « fait naître des idées nouvelles, montrent des dangers, jusqu'alors imprécis », et, alors, « des possibilités auxquelles on n'avait pas pensé s'imposent à l'esprit ». Car le paysage qu'examinent les habitants - leur paysage, leur village, leur quartier, leur cadre de vie - est fondamentalement un paysage politique. Un tel regard que chaque citoyen ou futur citoyen peut « porter efficacement sur le territoire où il vit et sur des alentours plus ou moins lointains », constitue même « un moyen de mieux comprendre ce qui se passe et ce qu'il peut faire ». (p.13)a - Le paysage est politique et les valeurs paysagères sont évolutives
Réfléchir sur les paysages, sur la notion de paysage, ne consiste pas seulement à comprendre un peu mieux ce qui se passe et comment ça se passe, mais doit aussi de suggérer des moyens pour que ça se passe différemment (p. 76). La tâche du géographe est donc de « s'efforcer d'aider le plus grand nombre de citoyens à savoir penser l'espace, et d'abord l'espace où ils vivent pour être plus en mesure de dire clairement ce qu'ils veulent » (p.77). Mais, pour autant, ce ne sont pas uniquement les géographes qui se soucient des paysages, c'est aussi l'affaire des artistes : peintres, cinéastes et écrivains. Et ce n'est sans doute pas un hasard, si l'un des plus grands romanciers français est, en fait, un géographe : « un vrai géographe, tant par sa formation que pour une grande part de son inspiration : Julien Gracq » (1910-2007) (p.15)
b - Estuaire et Sillon vus par Julien Gracq
 |
| Marquise de la gare de Savenay |
Plus tard, dans l'après-midi, Simon emprunte la "grande route de Bretagne " vers Pontchâteau (RN 165). À l'époque, « la route était faite de lignes droites uniformes bordées de chênes et de marronniers déjà jaunis par septembre ». Mais, à travers « le tunnel des branches », sur la gauche, « par la coulée de vallons, on apercevait derrière la crête qui surplombait la route les plaines mouillées qui longeaient l'estuaire. La brume s'était levée sur le lavis trempé du matin et la torche de la raffinerie rapetissait dans l'air sec » (p.54). De nos jours, de telles visions vers l'estuaire ne sont plus possibles depuis la RN 165 transformée depuis en voie express, mais elles le restent au détour d'un chemin de randonnée, à travers un percée dans les haies du remenbrement des années 1960.
Quant aux valeurs paysagères du lieu, elles ne sont guère positives dans le souvenir de Simon/Gracq : « La presqu'île qu'il allait traverser, avec ses ilots de terres basse mangées de toutes part par les marais, était l'ancien pays de ses vacances d'enfant ». Mais celles-ci, se déroulant sur la côte d'Amour, « n'avaient guère laissé de place aux excursions dans les friches mornes de l'intérieur. Quand il y pensait, son imagination se les représentaient comme une Terre Gâte, un pays muet, prostré dans sa disgrâce, et que devait avoir touché une espèce d'anathème » (p.51). Preuve que les valeurs paysagères sont relatives, et peuvent évoluer d'un siècle à l'autre. Sans négliger le fait qu'au milieu du XXe siècle, elles étaient dans le creux de la vague à Savenay, comme le suggère ainsi Gracq.
Yves Lacoste, Paysages politiques, Braudel, Gracq, Reclus..., LDP, Biblio, 1990.
Julien Gracq, La presqu'île, José Corti, 1970.
Sur Jean Rouaud lire également : "géographie de poche" d'une mémoire locale.
3 – Au tournant de 2000, dilemme du millénium : du Sillon ou d'Estuaire ?
Fernand Guériff (1988) : du haut du Sillon au Champ Michel (La Chapelle-Launay)
Dans un livre d'histoire de Fernand Guériff, musicologue et ethnographe nazairien, riche de précisions érudites, mais pamphlet violemment anti-révolutionnaire3, on trouve néanmoins cette pépite de géographie locale, peut-être la meilleure description de ce qu'est un panorama vu du Sillon de Bretagne :
« Le plus magnifique, le plus grandiose panorama du pays de Basse-Loire se déploie du haut du Sillon de Bretagne, dans un site naturel où il s'élargit de manière incroyable : cet observatoire idéal, c'est le Champ Michel en la Chapelle-Launay. L’œil y embrasse un arc immense de profondeur et d'étendue de Nantes à l’embouchure de la Vilaine, par temps clair. Dans le fond, la Loire miroite en ruban d'argent ; au-delà, le pays de Retz s'estompe dans un lointain vaporeux où pointent de rares clochers. » (page 62).
Certes aujourd'hui l'angle de vision est-il en partie réduit par la poussée de haies d'arbres, mais le regard peut toujours se porter du pont de Saint-Nazaire et des tours de distillation de la raffinerie de Donges, jusqu'aux quais de Paimboeuf, au-delà de la lame du fleuve, en passant par les réservoirs de la butte de Sem à Donges et ceux de Blanche couronne à la Chapelle-Launay, sans oublier la procession des camions sur la RN171, et de temps en temps, le sifflement métallique des trains sur les rails vers Redon ou vers Saint-Nazaire.
C'est un véritable défi pour les photographes que d'embrasser ce genre de panorama, avec ses brumes fréquentes et la faiblesse du dénivelé du Sillon de Bretagne. Pourtant, selon Guériff, pour se replonger dans le paysage tel qu'il pouvait être en 1793, date de son récit historique, « à nos pieds, il faut effacer la symphonie en vert des prés des jardins et des bosquets, vivante et changeante, pour restituer les landes sombres et sinistres d'autrefois, coupées de boqueteaux et de prés-marais ; il faut remplacer les routes luisantes de goudron par d'affreux chemins grossièrement empierrés », qui existaient à cet endroit à l'époque de la Révolution. Ce tableau rétrospectif est d'ailleurs corroboré par celui que l'agronome anglais Arthur Young trace des paysages de la région dans son « Voyage en France » à la veille de 1789. Il faut donc en retenir que les paysages changent, sont nécessairement évolutifs, et ne correspondent jamais à un quelconque "ordre éternel des champs"4 définitivement fixé.
C'est ce que confirme la lecture de "Des Rives, voyage dans l'estuaire de la Loire" (2019) , même s'il n'y est question que de l'en-bas de l'Estuaire métropolitain, laissant à l'écart les hauts du Sillon de Bretagne. Or, le point de départ de l'identité d'Estuaire et Sillon, n'est-il pas dans la complémentarité de leurs paysages ? Cela étant dit, c'est un magnifique ouvrage d'un journaliste et d'un photographe. Le premier, Guy-Pierre Chomette, rédacteur et auteur, "axe l'essentiel de son travail sur la problématique des territoires " dans une démarche d'enquête journalistique; le second, Franck Tomps, dans ce qui est aussi un album de belles photos, sous divers angles, d' "un paysage parfois complexe [...] met en adéquation la respiration des ses images avec la quiétude des grands espaces". Ils s'inspirent, eux aussi, de Julien Gracq pour qui "tout grand paysage est une invitation à le posséder par la marche". Le seul bémol, c'est que leur tour de l'estuaire par ses rives, laisse totalement à l'écart le Sillon de Bretagne, s'interdisant par là même d'explorer la complémentarité des rives de l'estuaire avec les paysages du Sillon. Par contre, vue de l'observatoire de Lavau-sur Loire, ils nous expliquent que :"Tadashi Kawamata aurait pensé les ouvertures de l'observatoire comme une galerie de peintures paysagères, l'une représentant la centrale de Cordemais déjà distante de sept kilomètres, l'autre donnant sur la rive sud de la Loire et la ville de Paimboeuf, une autre encore montrant l'aval, les torchères de la raffinerie de Donges, le pont de Saint-Nazaire et la silhouette des superstructures des chantiers navals »" (p.124).
 |
| La centrale de Cordemais |
Qu'ils soient vus des rives de l'estuaire ou des hauts du Sillon, on constate que les marqueurs paysagers restent les mêmes.
4 - Depuis 2000 : dans le flou du marketing touristique
Concernant l'espace perçu d'Estuaire et Sillon, l'évolution des représentations depuis 20 ans d'intercommunalité apparaît parfaitement dans les slogans successifs de l'office du tourisme local, porteur d'un marketing territorial de promotion touristique d'abord à l'usage des "horsains", et pour commencer les "bobos" métropolitains nantais en quête d'espace et de verdure.
D'abord, au début de l'intercommunalité », dans les années 2000, le territoire leur est promu comme « Loire et Sillon terre de sports et de loisirs ». Pour les "autochtones" du lieu, on leur parle alors volontiers de "bassin de vie" - mais beaucoup moins de bassin d'emploi - et surtout pas de "communes-dortoirs", un vocable soigneusement honni et banni. Alors que...
Ensuite, Loire et Sillon devient : « Paysages, pays sage ». L'accent est certes ainsi mis sur les paysages, et non plus seulement sur les pratiques sportives et de loisirs, au sujet d'un territoire assimilé - par des déguisements appropriés - à celui du Japon, mais, en vérité, sans aucun fondement géographique, au delà du jeu de mots ou du trait d'humour impulsé par le bureau d'étude idoine. Hélas, l'archipel japonais est connu au contraire comme un "terre de tous les dangers", de tous les risques naturels (tsunamis, tremblements de terre, typhons, tempêtes de neige, glissements de terrain...). L'appliquer à Estuaire et Sillon, cela tient des "japon(i)aiseries" (Philippe Pelletier, géographe spécialiste du Japon, 2017), sans fondement, ni pertinence. Autre déconvenue, en novembre 2018, le soi-disant « pays sage », devient sur ses ronds-points, celui des Gilets jaunes et de leur colère rompant brutalement avec la sagesse attendue.
Enfin, après la fusion de 2014, Estuaire et Sillon serait désormais devenu l'espace du "sentiment de la nature". Le "sentiment d'appartenance" réduit ainsi à un « état de nature » néo-rousseauiste. Soit, mais laquelle, exactement ? Cela fait toujours partie des valeurs paysagères et territoriales à clarifier : nature ? Verdure ? Campagne ? Ruralité ? Pour l'instant, elles restent encore dans le flou. Est-ce normal et supportable quand on devrait entamer incessamment la définition d'un Projet de Territoire resté en panne depuis les commencements de l'intercommunalité, mais rendu inévitable depuis la fusion de 2014. Quels paysages ? Quelle identité ? Pour quel projet ?
5 – Depuis 2014 : quelle place pour Estuaire et Sillon dans les projets métropolitains ?
Pour l'architecte renommé Frédéric Bonnet, Grand prix de l'urbanisme 2014, il faut partir du principe que « la nature structure l'urbain », mais n'est-ce pas plutôt l'inverse ? Selon lui,
« une nette résistance semble opposer en France nature et ville. La nature serait soit en péril, soit périlleuse. Pourtant la nature est une matrice, une richesse, un bien commun. La nature est aussi le vivant, le sol, le climat, l'eau, le jour, la nuit, le vent... Elle transcende les césures administratives. La nature est aussi d'une autre durée, très étirée. Elle est hors mode, hors temps. »5
L'architecte-urbaniste, avec son groupe Obra, est investi dans le programme métropolitain nantais, "Eau et paysages". À travers lui, il s'agit d'exprimer l'idée de la métropole puisse tirer mieux parti des paysages spectaculaires de l'estuaire de la Loire. La diversité des sites devient alors une chance : balcon sur l'horizon ligérien, vallées bocagères, marais de Brière et de Loire. Depuis 2013, le principe d'action de son « étude de composition urbaine et paysagère » repose sur la mise en réseau de six sites choisis avec « un très grand nombre de "trésors" paysagers identifiés sur l'estuaire », en ciblant « les maillons qui manquent dans un réseau étendu de promenades, trains, parcours vélo et bacs transloires ». Dans ces conditions, nul besoin pour lui d'un "grand geste" métropolitain, mais plutôt d'une démarche qui parte « des actions courantes déjà programmées de chaque commune. Une salle de fêtes, un aménagement de quai, une petite Zac, un café répondraient ainsi à un usage local ». Pour mieux « habiter l'estuaire de Nantes à Saint-Nazaire (...) une solidarité métropolitaine est à construire entre des territoires singuliers » (p.30). J'ai eu le privilège de d'interroger Frédéric Bonnet au cours de son audition dans le cadre du premier Grand Débat métropolitain : Nantes, la Loire et Nous, en 2015.
 |
| Le programme Eau et paysage (Cabinet Obras-Phytolab) |
Vidéo de l'audition de Frédéric Bonnet dans le cadre du débat « Nantes, la Loire et Nous » 2015 : le fleuve de la ville à l'estuaire
Frédéric Bonnet 2015
L'extension du domaine de l'urbain au nord du fleuve Loire, dans le périurbain nantais comme ailleurs, inclut donc, selon Ariella Masboungi, le fait que la nature puisse recomposer l'urbain. Un enjeu qui converge avec celui de la prise en compte des risques et offre l'opportunité de ménager la nature dans son rôle de régulateur urbain, en particulier quand le risque prend la forme de l'inondabilité, plus déterminante que jamais pour réorganiser l'urbain, tenant compte des risques annoncés du "réchauffement climatique", pense-t-elle.
À suivre avec :
2/3 : POUVOIR : une "gouvernance" intercommunale à déconfisquer (en juillet)
3/3 : COLÈRES : les barbares péri-métropolitains se rebiffent (en août)
2 May Picqueray, May la réfractaire : 81 ans d'anarchie, 1979.
3 Fernand Guériff, La bataille de Savenay dans la Révolution, 1988.
4 Roland Maspétiol, "L'ordre éternel des champs : essai sur l'histoire, l'économie et les valeurs de la paysannerie". Librairie de Médicis, 1946.
5 Frédéric Bonnet, Eau et paysages du Lac au Port in : "Extension du domaine de l'urbanisme", 2014.


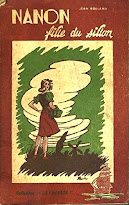




Commentaires
Enregistrer un commentaire