Par Laurent Devisme*, dans Place publique, Revue urbaine nantaise #75 p.83-84, Été 2020.
La géocritique des espaces périurbains, voilà l’objet principal du dernier ouvrage** du géographe Jean-Yves Martin. Il combine plusieurs objectifs, le titre le dit bien : décrire et analyser des morphologies, des pouvoirs à l’œuvre – mais le titre retient "pouvoir" au singulier – et des mobilisations. Ce depuis un lieu de vie, l’entrevilles et plus précisément La Chapelle-Launay entre Nantes et Saint-Nazaire où l’auteur vit depuis près d’un demi-siècle.
Disons-le d’emblée, c’est un livre composite, par la variété des thématiques abordées et parce qu’il laisse aussi la place à d’autres locuteurs : s’y déploient des conversations à distance avec des auteurs vivants et morts, place y est laissée à des extraits de presse locale, au propos de correspondants de presse, amis historiens et géographes, autant d’encarts qui décentrent le propos. Mais si l’on trouve une mosaïque d’objets de recherche, c’est en suivant un fil, l’enjeu d’actualiser le droit à la ville et une grille de lecture qui est celle proposée par le philosophe et sociologue Henri Lefebvre dans les années 1970, notamment la triade qu’il identifiait alors différenciant espace conçu, espace perçu et espace vécu. Si l’on peut considérer ce livre comme un essai "lefebvrien", son intérêt est qu’il est écrit depuis les espaces-temps de vie professionnelle, citoyenne et militante d’un géographe pointant des paradoxes et aberrations dans l’organisation et la gestion de l’espace périurbain.
ÉLUS, TECHNOCRATIE ET DÉCISIONS
Ces chapitres de la deuxième partie peuvent être considérés comme le noyau dur de l’ouvrage montrant une gouvernance intercommunale "anti-participative", pointant aussi le problème d’une faible maîtrise des dossiers par les élus communautaires au profit d’une technocratie : les décisions, souvent, sont bel et bien confinées ! Les enquêtes sont souvent précises, notamment sur le financement des services publics et leur opérationnalisation, mais la montée en généralité est parfois abusive. Il est en tous cas utile de mettre en avant un certain malaise dans l’organisation technico-politique de la coopération intercommunale.
Ces chapitres sont encadrés par des parties plus sensibles et introspectives. On retrouve ainsi en première partie les compagnons de route du géographe soucieux de tenir ensemble une connaissance fine de la géographie physique et humaine, l’évolution du climat, les arpentages de la géographie estuarienne. Le lecteur est un peu frustré de ne pas entrer davantage dans les controverses de la commission syndicale de la Grande Brière Mottière aux prises avec un marais indivis. Cette partie est plus de l’ordre du collage, elle aide en tous cas à la compréhension d’une géo-histoire particulière : les espaces périurbains sont tout sauf atones et amorphes !
Suite aux enquêtes sur les réseaux sociotechniques de la deuxième partie, ce sont les colères exprimées par les gilets jaunes qui retiennent toute l’attention du géographe. Cela commence par un court chapitre intéressant sur les vicissitudes du pôle d’échanges multimodal de Savenay, dans la foulée d’une histoire ferroviaro-routière qui a heureusement vu l’abandon d’un schéma autoroutier à la fin du 20e siècle qui aurait fait de ce pôle secondaire essentiellement un échangeur. On retrouve ensuite notamment des analyses que le géographe Michel Lussault a pu faire des expressions révoltées de la condition périurbaine. Étrange mouvement social certes, qui doit beaucoup aux réseaux sociaux (le groupe Facebook de Savenay) et montre la centralité de Donges dans les mobilisations et l’absence de réponses à une condition spatiale sous pression.
La dernière partie relève plus d’une autobiographie intellectuelle instructive : on retrouve les fondements d’une géographie critique avec ses auteurs phares dont le brésilien Milton Santos. Occasion pour nous de renvoyer à l’ouvrage précédent de l’auteur, Mobilisations populaires au Brésil. 1985-2015 (éditions du Petit pavé) qui associait une connaissance de terrain des mouvements socio-territoriaux brésiliens au déploiement des pensées critiques de Lefebvre et Foucault. Occupation, campement et installation y étaient alors analysées, des formes que l’on retrouve aussi dans l’estuaire à l’hiver 2018.
LAURENT DEVISME
* Laurent Devisme est professeur d’études urbaines à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes. Il est membre du comité de rédaction de la revue urbaine nantaise Place publique.
** Jean-Yves Martin, Paysages, pouvoir et colères du Sillon à l’Estuaire. Audit participant d’un espace périurbain vécu, éditions du Petit pavé, 260 pages, 25 €.



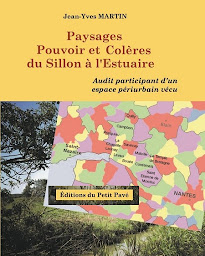

Commentaires
Enregistrer un commentaire